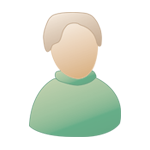Avant toute tentative de définition de la vie à des fins scientifiques ou philosophiques, il convient de rappeler que nous sommes tous capables de reconnaître instantanément la vie, discriminer l'animé de l'inanimé semble être une remarquable capacité cognitive de tout être humain. Nous reconnaissons les animaux par leur mouvement et leur forme, et les plantes par les motifs répétitifs des feuilles et des tiges.
Bien sûr, cette intuition n'est pas infaillible. Les microscopistes des XVIIe et XVIIIe siècles doutaient s'ils observaient de véritables créatures microscopiques ou des corps non organiques soumis au mouvement brownien. De même, au XVIIIe siècle, on discutait beaucoup de la question de savoir si les spores étaient « vivantes » ou non : représentaient-elles une forme de « vie latente », ou étaient-elles capables de « ressusciter » (Tirard2003,2010) ? Aujourd'hui, nous avons des doutes similaires si nous nous demandons : un virus est-il un être vivant ? Un écosystème – ou même la biosphère dans son ensemble – est-il « vivant » et (peut-être pas exactement la même question) un « être vivant » ?
On dit souvent que de nombreux termes scientifiques fondamentaux, sinon tous, sont difficiles à définir. Il ne faut donc pas s'étonner, selon l'argument, que la «vie», peut-être le terme le plus abstrait de la biologie, soit difficilement définissable. Cependant, l'assimiler à des termes tels que « matière » ou « énergie » est infondé. Premièrement, bien que nous ayons un certain nombre de représentations intuitives de la matière et de l'énergie - la plupart enracinées dans des cultures particulières - nous n'en avons pas une intuition aussi immédiate et cosmopolite que nous en avons de ce que signifie être "vivant". Deuxièmement, contrairement aux termes physiques tels que « force » et « énergie » en physique », ou « gène » en biologie, la « vie » ne fonctionne pas comme un concept théorique dans la biologie moderne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un terme désignant une entité non observable intervenant dans des hypothèses fondamentales susceptibles d'expliquer des classes de phénomènes.
un aspect important de la notion intuitive de vie est son aspect antagoniste : ce qui compte, c'est l'opposition entre « vivant » et « non-vivant », plus qu'un contenu particulier attaché à la notion abstraite de « vie ». La raison en est que pour une infinité de situations pratiques, biologiques et sociales, on a besoin d’être capable de faire la distinction entre les êtres vivants et non vivants. Il ne faut donc pas s'attendre à pouvoir tirer une définition de cette expérience originale, car notre appareil cognitif n'a pas été initialement conçu pour cela. Au mieux, la psychologie et les sciences cognitives pourraient fournir une liste des critères discriminants que les humains utilisent pour reconnaître la vie dans des situations variées.
Deux types de définition doivent être soigneusement distingués : les définitions lexicales (basées sur les usages courants d'un mot) et les définitions stipulatives ou législatives, qui attribuent délibérément un sens à un mot, dans le but d'éclairer des arguments scientifiques ou philosophiques.
Trois définitions philosophiques traditionnelles de la vie, qui ont toutes été élaborées avant l'émergence de la biologie comme
discipline scientifique spécifique : la vie comme animation (Aristote), la vie comme mécanisme et la vie comme organisation (Kant). Les trois concepts constituent un patrimoine commun qui structure en profondeur une bonne partie de nos intuitions et de notre vocabulaire culturels chaque fois que nous tentons de penser la « vie ».
Pour Popper, l'essentialisme (un mot inventé par lui-même) est une conception de la connaissance scientifique qui privilégie des questions du type « Qu'est-ce qu'une certaine sorte de chose ? », ou « Quelle est sa vraie nature ? ». Privilégier de telles questions conduit à une pratique fondée sur l'idée que la tâche essentielle de la science est de définir, au sens d'exprimer l'essence de quelque chose. Popper considère que cette attitude a été la source majeure de stérilité dans l'histoire des sciences comme dans la philosophie depuis l'Antiquité. La véritable connaissance, pour Popper, ne consiste pas à définir des termes puis à déduire quelque chose de ces énoncés fondamentaux (comme dans la méthode démonstrative d'Aristote), mais à formuler des hypothèses.La science ne vise pas à révéler des essences à travers des définitions, mais à décrire et à expliquer le comportement des choses dans des circonstances données, à travers des lois universelles conjecturales. Cela ne signifie pas que les définitions sont sans importance. Elles sont nécessaires, bien sûr, mais uniquement d'un point de vue pragmatique : nous avons besoin de définitions pour une communication claire. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de dire « ce qu'est quelque chose », mais « ce que nous entendons par quelque chose » dans un contexte scientifique donné. Les définitions doivent toujours être comprises d'une manière nominaliste, non essentialiste ; ce ne sont que des « abréviations utiles ». Avec un admirable sens pédagogique, Popper dit que les définitions « doivent être lues, non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche ». Il voulait dire par là (par exemple) que ce qui compte n'est pas « Qu'est-ce que la vie ? mais "Qu'appelle-t-on la vie ?". Ce qui compte, ce sont les hypothèses que nous faisons sur les phénomènes observables ; les définitions doivent être subordonnées à cet objectif premier de la science (Popper 1945, II : 1–24).
Biologie : En 1766, Christian Hanov, disciple du philosophe Christian Wolff, l'utilisa (en latin encore) dans le titre d'un grand traité dans lequel il défendait l'idée d'une science vouée à l'étude des lois les plus générales communes aux plantes et aux animaux (pour cette importante découverte historique, voir McLaughlin2002). Cela cadre bien avec une affirmation commune aux historiens des sciences, selon laquelle l'idée d'une science entièrement et exclusivement consacrée aux phénomènes de la vie et aux êtres vivants, serait apparue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il remet également l'origine du mot plus de trois décennies plus tôt que le récit traditionnel. En effet, lorsque Treviranus, Lamarck et Bichat introduisirent solennellement le mot « Biologie » en allemand et en français, leur proposition ne venait pas de nulle part. Le mot « biologie » et l'idée d'une science englobant les phénomènes de la vie dans toutes ses dimensions (lois générales, classification et histoire) existaient déjà.
La théorie cellulaire a été la première étape. Puis est venue la théorie de l'évolution, et enfin la biochimie et la biologie moléculaire, qui ont montré que tous les êtres vivants connus sont faits de la même matière (acides nucléiques, protéines, etc.), et présentent une unité métabolique remarquable (existence universelle de mécanismes et de voies métaboliques quasi universels). Notez qu'aucune de ces sous-disciplines de la biologie n'a jamais tenté de définir la vie. Mais tous ont définitivement montré qu'il existe de très fortes raisons de croire que les êtres vivants partagent un certain nombre de propriétés qui les distinguent de tout autre être naturel, et qui justifient l'existence d'une science méthodologiquement autonome.
Presque toutes les définitions actuelles de la vie sont des tentatives plus ou moins convaincantes en ce sens. Certains insistent sur les membranes et le métabolisme, d'autres sur la reproduction et l'évolutivité, d'autres sur les « briques de base » du vivant (molécules organiques). D'autres encore tentent de fournir une formule aussi abrégée que possible.
les grandes possibilités théoriques semblent avoir été épuisées avant le XIXe siècle. Georges Canguilhem, dans un article mythique (Canguilhem1968), identifie trois concepts majeurs de la vie, chacun associé à un philosophe hors pair : la vie comme animation, la vie comme mécanisme et la vie comme organisation.
1) L'animisme est certainement la notion la plus ancienne et la plus universelle de la vie. Elle définit et explique la vie par un principe spécifique, l'âme. Aristote a fourni l'élaboration la plus impressionnante de cette conception. Sa déclaration la plus importante est peut-être que l'âme est la cause de la vie en ce sens qu'elle est l'exercice coordonné de toutes les capacités d'action du corps. L'âme, dit Aristote, est pour le corps tout entier ce que la vue est pour l'œil. L'âme est donc à la fois l'ensemble des fonctions et leur coordination.
2) Le concept de la vie comme mécanisme fait exactement le postulat inverse. Selon elle, toutes les fonctions vitales ne sont que des mécanismes, et le corps vivant lui-même est une machine. Bien qu'il soit beaucoup plus compliqué que n'importe quel artefact fabriqué par l'homme, il ne nécessite pas un type particulier de principe théorique pour expliquer son fonctionnement. Descartes a donné à cette conception sa forme la plus élaborée. La conception mécaniste de la vie est fondée sur une représentation de la nature qui n'admet pas une réelle distinction entre corps non vivants et corps vivants. Poussée à ses limites, la conception mécaniste de la vie conduit à éviter le mot « vie ». C'est exactement ce qui se passe dans les oeuvre de Descartes.
3) La dernière conception philosophique de la vie consiste à mettre l'accent sur l'organisation, et par conséquent, elle identifie les êtres vivants à des « organismes ». Cette conception s'est développée tout au long du XVIIIe siècle, et a conduit à l'invention et à la diffusion du mot « organisme », devenu courant au début du XIXe siècle. C'est venu comme une sorte déterminants tant pour les animistes que pour les mécanistes, parce qu'elle s'appuie à la fois sur des intuitions mécanistes (le corps vivant assimilable à un organe - l'instrument de musique capable de jouer par lui-même, sur la base de ses propres mécanismes), et sur des idées animistes (« organisation » et « organisme » viennent pour le mot grec organon, qui signifie un moyen par rapport à une fin d'où la connotation finaliste de ces mots). Emmanuel Kant, dans sa Critique du jugement, a fourni une remarquable élaboration philosophique de cette conception. Il a proposé d'assimiler les notions de « finalité naturelle » et « d'être organisé » (le contexte précisant que les êtres organisés sont des êtres vivants). Un être organisé, explique Kant, est un être dans lequel toute partie est à la fois un moyen et une cause productive pour les autres.
Un tel être est différent d'une machine, dans laquelle chaque pièce est un moyen par rapport aux autres, mais n'est en aucun cas « produite » par elles. Dans le même texte, Kant insiste également sur le fait que les « êtres organisés » sont capables de « s'auto-organiser » (s'auto-entretenir, s'auto-réparer et s'auto-reproduire).
il convient de rappeler que donner une définition et donner un critère opérationnel ne sont pas nécessairement la même tâche. Une définition est une construction théorique, idéalement fondée sur un ou plusieurs caractères que nous croyons essentiels à la chose définie, même si nous n'adoptons pas une position réaliste ou platonique par rapport aux définitions. Une bonne définition est celle qui capture quelque chose d'important en termes de contenu conceptuel du terme défini.
Un certain nombre d'auteurs, dont peut-être certains dans ce volume, sont convaincus qu'il existe une frontière nette entre le vivant et le non-vivant, car la différence n'est pas une question de science historique, mais une question de physique, ou quelque chose comme ça. proche d'elle. Elle est décrite par une science nomologique, non par une science « idiopathique »1.
Ces auteurs pensent qu'une propriété hautement abstraite est la signature de la vie et est le résultat d'une sorte de saut ou de bifurcation dans le comportement d'un certain type de système dynamique.
Bien sûr, si les systèmes vivants reposent sur des propriétés sui generis qui leur appartiennent universellement en vertu des lois de la nature, le problème de définir la vie revient à identifier ces lois.
1 Science nomologique : une science basée sur des énoncés universels de portée illimitée (lois). Sciences idiopathiques : sciences traitant d'événements qui ne se produisent qu'une seule fois.
Les définitions stipulatives :
1) Ruiz-Mirazo/Peretó/Moreno:
"[La vie est] un réseau complexe d'agents autonomes auto-reproducteurs dont l'organisation de base est instruite par des enregistrements matériels générés par le processus historique ouvert dans lequel ce réseau collectif évolue."
2) NASA Brack:
"La vie est un système chimique autonome capable de subir une évolution darwinienne."
3) Popa
"Les entités vivantes sont des systèmes auto-entretenus, capables d'évolution adaptative, individuellement, collectivement ou en filiation."
"Être en vie est l'état d'expression de ces capacités."
"La vie est un concept indiquant que la capacité d'exprimer ces attributs est virtuellement
ou réellement présente."
4) Damiano et Luisi :
"Un système est vivant quand [il] s'auto-entretient en raison d'un réseau régénérateur de processus se déroulant dans les limites de sa propre fabrication, et qui a une interaction cognitive adaptative avec le médium."
5 )Maturana et Varela : «Un système vivant est un système qui est capable de s'auto-produire et de s'auto-entretenir grâce à un réseau de processus de régénération à l'intérieur d'une frontière de sa propre fabrication.
deux catégories :
1) l'auto-entretien individuel et l'évolution indéfinie d'un ensemble d'entités semblables.
2) Sans la reproduction et l'évolution, et adoptent une sorte de vision psychique du vivant, qui met également l'accent sur l'environnement.
Les échos aux grands débats théoriques qui caractérisent les recherches actuelles sur les origines de la vie : La relation entre ce débat fondamental et le problème de l'origine de la vie est assez simple (même si, encore une fois, n'étant pas spécialiste, j'ai conscience de simplifier à l'excès). Il semble clair que si l'on met l'accent sur des entités théoriques telles que les cycles métaboliques, les vésicules et les membranes, et une sorte de compartimentation, on privilégie une approche fonctionnelle de la question de ce que sont les êtres vivants. Une telle approche cadre bien avec l'idée que ce qu'il faut expliquer, c'est l'émergence de systèmes individuels auto-entretenus. Si tel est le cas, l'émergence de la vie se résume (dans une formulation philosophique large) à l'émergence de l'individualité. Par contre, si vous insistez sur la réplication des polymères, sur la reproduction des assemblages de tel ou tel type de molécules, et sur l'évolution des populations de quelque chose, vous serez probablement amené à mettre l'accent sur une notion de la vie en termes de collectifs, descendance et histoire des collectifs apparentés.
 Defining Life Conference Proceedings Jean_Gayon_2_292522.pdf
Defining Life Conference Proceedings Jean_Gayon_2_292522.pdf